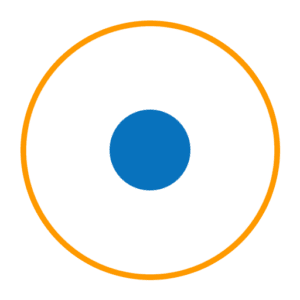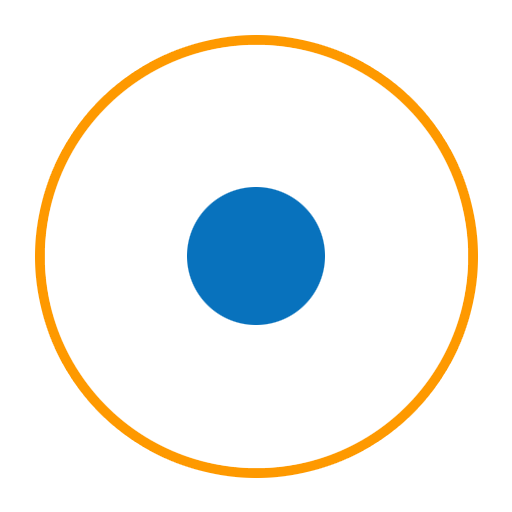Nous n’y sommes pas habitués.
Il n’y a jamais eu l’ombre d’une véritable équité depuis que la disposition transitoire antifasciste de la Constitution italienne s’est sclérosée, jusqu’à devenir une sorte de polype tumoral abusif que l’on voudrait désormais inamovible.
Depuis 1972
nous avons toujours vécu dans le climat propagandiste et juridique hérité de l’épuration d’après-guerre, climat qui fut réactivé afin de conduire le Parti communiste dans la sphère gouvernementale. Comme nous le savons bien, il en est ressorti l’idée que « tuer un fasciste n’est pas un crime » : presque aucun des assassins ne fut condamné, et les très rares qu’il fut impossible d’épargner virent systématiquement leurs crimes requalifiés et leurs peines réduites à une simple formalité.
Il n’y a pas lieu de se lamenter. Tout cela nous a endurcis et, surtout, a mis en lumière l’hypocrisie de l’injustice ainsi que le poids réel des rapports de force.
Aujourd’hui, les antifascistes
commencent à être sanctionnés — non pas tant chez nous, où le gouvernement Meloni, qui ne s’est d’ailleurs jamais plié à leurs chantages, entend démontrer qu’il ne se comportera pas ignoblement comme ils l’ont toujours fait — mais dans des pays où l’on ne s’y attendait guère : les États-Unis, l’Allemagne et la France. Les deux derniers, réputés pour leurs persécutions idéologiques à l’encontre de la droite radicale, surprennent particulièrement.
En Allemagne, la Hammerbande, avec laquelle Ilaria Salis (deputée eruopéenne italienne) parcourait l’Europe, a été poursuivie en tant qu’organisation terroriste internationale, et l’une de ses ressortissantes a été extradée vers la Hongrie, où elle a été condamnée pour l’attaque lâche perpétrée en 2023 à Budapest contre des manifestants pacifiques et désarmés. D’autres militants allemands se sont réfugiés en Thaïlande.
En France, après le lynchage de Quentin, il y eut non seulement sept arrestations, mais aussi une vague d’indignation générale. Celle-ci s’est traduite par l’interdiction d’accès à l’Assemblée nationale pour un assistant parlementaire de La France insoumise, sans compter le débat public sur l’éventuelle dissolution du parti de Mélenchon. Ce dernier, après avoir tenté de défendre d’une certaine manière les assassins de Quentin, a dû faire marche arrière, submergé par une réaction publique inattendue.
En Italie, la population du quartier génois mis à sac par les antifascistes s’est soudainement mobilisée et a massivement signé une pétition demandant leur dissolution.
Aux États-Unis, les antifa figurent depuis longtemps sur la liste des organisations considérées comme terroristes potentielles.
À quoi devons-nous cette évolution ?
Le premier facteur réside dans le choix pro-Hamas et « islamo-gauchiste », qui a irrité non seulement des communautés avec lesquelles, jusqu’à récemment encore, les antifa entretenaient d’excellentes relations, mais aussi les habitants de nombreux quartiers populaires européens. En jouant à l’intifada de salon, ils se sont dangereusement éloignés de la réalité.
Le deuxième facteur relève également d’un grave décalage avec le réel. Enfermés dans leurs ghettos marginaux et dans une bulle psychotique, ils se sont entraînés durant des années à rejouer le biennio rosso (1920-21 guerre civile en Italie) ou, plus modestement, les années soixante-dix. Ils ont été encouragés en cela par leurs complices les plus cyniques : des semeurs de haine rémunérés par certains journaux ou associations dites démocratiques.
Ils se sont organisés de manière capillaire, dans une sorte d’« Erasmus du lynchage ». Ils ont parcouru l’Europe — et pas seulement l’Italie — pour frapper, massacrer, tuer (cinq personnes dans trois pays). Ils ont eu recours à plusieurs reprises à des explosifs.
La différence, par rapport aux années soixante-dix, est qu’ils ont agi seuls. Non parce qu’il y aurait en face de la peur ou un manque de détermination, mais parce que, dans la société transformée d’aujourd’hui, il n’existe plus d’espaces physiques à conquérir et à contrôler : tout se joue dans un affrontement diffus, presque immatériel.
L’ancienne justification selon laquelle il y aurait eu « deux terrorismes » ne tient donc plus. De l’autre côté, il y a moins de psychopathie et moins d’anachronisme que chez ces antifa enfermés dans leur propre délire criminel.
Pour maintenir vivante la « menace fasciste », les minorités d’inspiration soviétique qui les protègent ont constamment criminalisé la mémoire des victimes — présentée comme le véritable danger issu de la droite radicale — tout en minimisant les meurtres commis. À Milan, ils ont même réussi à interdire la marche en mémoire de Sergio Ramelli, tout en autorisant celle qui rendait hommage à ses assassins.
Le troisième facteur correspond à ce que le marxisme appelle un « défaut de correspondance » avec la réalité. La classe dirigeante communiste et progressiste a bâti son pouvoir selon des méthodes industrielles et militaires, occupant des positions qu’elle se transmet de génération en génération.
L’anomalie persistante de la magistrature italienne — dénoncée dans toute l’Europe — constituée sous le dirigeant du Parti communiste, Togliatti, qui fut ministre de la Justice après la Seconde Guerre mondiale. et maintenue depuis huit décennies, en est une illustration frappante. Une nation entière, et une grande partie de la magistrature elle-même, se trouvent prises en otage par quelques procureurs qui n’ont de comptes à rendre à personne pour leurs décisions arbitraires. Ils se posent même en législateurs et en commissaires politiques chargés de « rééduquer » les Italiens, y compris les électeurs.
Si cette classe dirigeante a su imposer son idéologie
en tant que minorité organisée dominant les masses, elle n’a pas su appréhender l’ampleur des crises sociétales que cette idéologie n’est plus en mesure de gérer. Elle a en outre commis l’erreur de radicaliser les dérives woke et les théories de genre, en les accompagnant de lois autoritaires qui ne font que révéler l’érosion de son contrôle.
Or, si les classes dirigeantes sont chargées d’arbitrer entre intérêts économiques et psychologies collectives, elles ne déterminent ni les uns ni les autres. Les expressions les plus extrêmes et archaïques du progressisme et de l’héritage communiste — en particulier le « cirque antifasciste » — n’ont dès lors plus de raison d’être soutenues.
Dans leur crise de déconnexion avec le réel, elles se sont éloignées non seulement de la société, mais aussi des nouvelles dynamiques de pouvoir et des transformations globales.
Reste enfin le facteur que mon fils a souligné
les antifascistes militants sont massivement impopulaires. Ils n’ont d’ailleurs jamais été populaires. On les a toujours perçus pour ce qu’ils sont : des enfants gâtés jouant aux révolutionnaires avec arrogance, protégés d’en haut et dépourvus de toute véritable éthique, qu’ils remplacent par la justification idéologique de se poser en justiciers face à une prétendue tyrannie.
Nous savons cependant qu’il y a une différence entre le sentiment populaire et le courage de l’exprimer. Beaucoup le pensaient depuis longtemps sans oser le dire publiquement.
Aujourd’hui, quelque chose a changé. Les gens ont un instinct sûr : lorsqu’ils estiment qu’un groupe est puissant, ils évitent de l’affronter ouvertement, se contentant de le sanctionner en silence ou dans les urnes.
Si désormais beaucoup accusent ouvertement ces groupes, cela signifie qu’ils sont réellement en train de perdre du terrain.