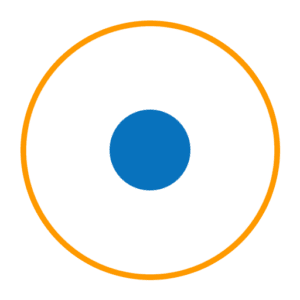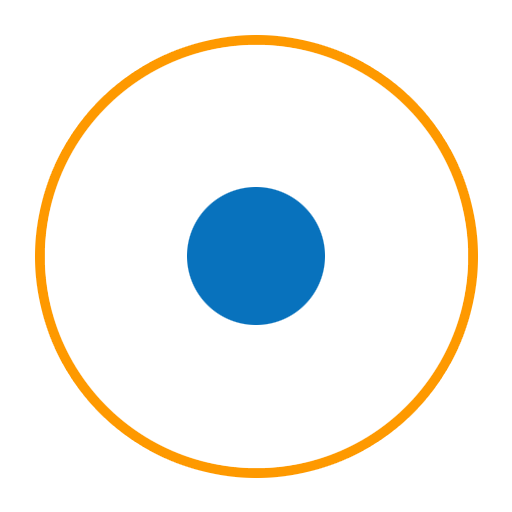Trump a accordé un sursis à Poutine — et lui a même tendu un beignet.
C’est si manifeste que même la presse américaine et plusieurs propagandistes russes s’en sont aperçus.
Tout cela s’inscrit dans la logique d’une Yalta éternelle : si la Russie ne parvient pas à débloquer la situation d’ici l’automne, elle risque de ne plus jamais en avoir l’occasion — sauf à bénéficier d’une intervention militaire, américaine ou chinoise.
Mais cet avant-dernier — ou peut-être antépénultième — ultimatum trumpien comporte une autre facette.
Malgré les nombreuses contradictions qui ponctuent ses déclarations, Trump a affirmé que, dans cinquante jours, il lèvera les restrictions pesant sur le soutien européen et imposera enfin des sanctions structurelles contre Moscou.
Un tel scénario n’a rien d’impossible si l’on considère les précédents de la politique étrangère américaine.
Les précédents sont clairs : les États-Unis ont souvent combattu — ou feint de combattre — un ennemi dans le but d’en affaiblir un autre.
Dans les deux guerres mondiales, la véritable cible stratégique de Washington n’était autre que l’Empire britannique, ce qui explique pourquoi les premières victoires du Japon furent accueillies avec bienveillance.
Churchill — l’homme qui précipita le déclin de la puissance impériale britannique — joua en réalité le rôle d’un agent objectif de l’ennemi à Londres, facilitant l’exécution du plan rooseveltien de refonte de l’ordre mondial.
Historiquement, les États-Unis ont plus souvent trahi leurs « alliés » qu’affronté leurs ennemis réels.
Le cas ukrainien n’échappe pas à cette logique.
Tout en affichant leur soutien aux envahis, les États-Unis continuent de fournir aux forces russes des composants militaires essentiels et le savoir-faire nécessaire à la poursuite du conflit — tout en s’approvisionnant en uranium russe pour alimenter leur propre industrie nucléaire.
Ce contexte évoque moins la Seconde Guerre mondiale que la Première.
Pendant plus de deux ans, les États-Unis ont financé les deux camps. La finance juive américaine soutenait les empires, tandis que la finance protestante se rangeait du côté des démocraties.
À la fin de 1916, un basculement stratégique eut lieu : Washington misa tout sur le Royaume-Uni — qu’elle assujettit par la dette — et abandonna les empires centraux.
Avec la Révolution russe, les États-Unis s’imposèrent brutalement dans les affaires européennes.
Les Américains pourraient-ils, du jour au lendemain, cesser de soutenir leur faux ennemi russe — qui agit en réalité comme sa véritable troupe coloniale — et le laisser s’effondrer ?
Ce n’est pas exclu, surtout si les fidèles mais brutales marionnettes de Moscou continuent de faire preuve d’une incompétence flagrante, tant sur le plan politique que militaire.
Il ne faut pas oublier qu’à l’époque où le système russe fonctionnait, il était dirigé par des élites géorgiennes et ukrainiennes ; ce n’est plus le cas aujourd’hui — et cela se voit.
Poutine — qui, en trois ans et demi, a causé à la Russie plus de torts que la Perestroïka — pourrait-il aller jusqu’à rompre cette relation historique de dépendance envers les États-Unis, dont la Russie fut longtemps le serviteur le plus zélé et le protégé le plus constant ?
C’est parfaitement envisageable. Si Moscou échoue à infléchir le cours de la guerre dans les trois mois et demi à venir, une dégradation brutale de la situation ne peut être exclue.