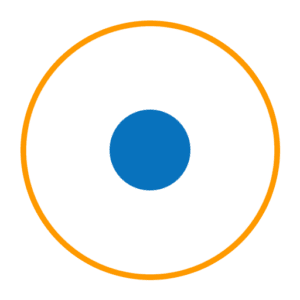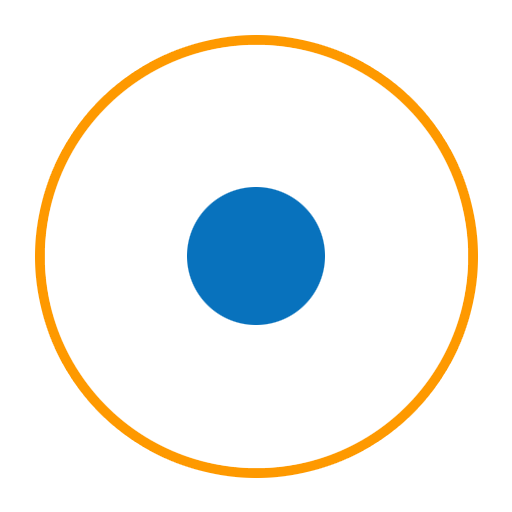Quel est l’état actuel des conflits et des équilibres internationaux ?
Commençons par un point souvent négligé : le modèle capitaliste et internationaliste s’est imposé partout dans le monde — à l’exception partielle de la Corée du Nord. Les différences entre les acteurs globaux tiennent avant tout aux spécificités culturelles locales, à la profondeur stratégique de leurs territoires et à leur projection géographique.
Il n’existe actuellement aucune véritable alternative à ce modèle ; seulement des déclinaisons plus ou moins sophistiquées, plus ou moins efficaces, intelligentes ou archaïques, productives ou parasitaires du même système.
Ce constat peut déconcerter ceux qui se plaisent à imaginer des scénarios fantaisistes, teintés de références « tolkieniennes », qu’ils qualifient volontiers de « géopolitiques » — un terme devenu l’équivalent du ketchup : on le met partout, sans discernement, pour donner du goût à ce qu’on ne parvient pas à comprendre.
Il n’y a ni affrontement idéologique structuré, ni véritables blocs géopolitiques rivaux.
Considérer les BRICS comme un bloc stratégique homogène est une erreur. Non seulement en raison des rivalités internes — notamment entre la Chine et l’Inde —, mais aussi parce qu’il ne s’agit que d’un regroupement opportuniste, l’un des nombreux agencements internationaux tâtonnants apparus à la suite de la grande crise de 2008.
Depuis cette date, la Chine, après trois décennies de subordination de fait à Washington, s’est hissée parmi les premières puissances économiques mondiales
Ce bouleversement — antérieur même à l’ère Trump — a contraint les États-Unis à contenir un second rival économique et technologique de taille, après l’Allemagne, devenue entre-temps le moteur de l’Union européenne.
Les documents stratégiques émanant de la Maison-Blanche ne font que refléter ces deux préoccupations majeures. La Russie, en comparaison, n’occupe qu’une place marginale — sauf en ce qui concerne ses livraisons énergétiques à l’Allemagne.
Il faut y ajouter le repositionnement énergétique engagé par les États-Unis dès 2001, ainsi que le lien de plus en plus étroit entre ressources naturelles et technologies émergentes, qui redéfinit aujourd’hui les équilibres mondiaux. Le grand hub gazier israélo-arabe, par exemple, est au cœur de nombreuses décisions stratégiques prises par le gouvernement Netanyahu.
La volonté américaine de préserver son hégémonie globale s’exprime désormais à travers différentes stratégies, mais repose sur trois constantes :
Saboter les mécanismes de régulation internationale, y compris ceux que les États-Unis ont eux-mêmes mis en place — comme l’OMC. Il est d’ailleurs ironique de constater que ce sont aujourd’hui la Chine, la Russie, l’Inde, l’Indonésie, l’Amérique latine ou l’Union européenne qui défendent avec le plus de ferveur les principes du globalisme.
Externaliser la gestion régionale ou macro-régionale à différents acteurs en les maintenant en compétition permanente, tout en veillant à les garder connectés, même indirectement, à Washington.
Maintenir une présence constante sur le plan militaire et diplomatique, en s’efforçant de diviser — ou du moins de contenir toute dynamique d’unité — parmi les puissances émergentes ou régionales. L’Europe est la première cible de cette logique d’équilibre contrôlé.
Donald Trump a poussé cette stratégie à l’extrême, de manière explicite. Quant à ses résultats, ils restent à évaluer : certains effets semblent lui donner raison, d’autres non. Par exemple, les investissements directs étrangers aux États-Unis ont baissé, tandis qu’ils ont augmenté en Europe. Cela constitue un revers dans la guerre monétaire transatlantique que les États-Unis semblaient avoir remportée grâce — entre autres — à l’invasion russe de l’Ukraine et à ses conséquences.
En Europe, on caresse l’idée d’un renouveau de l’euro sur la scène internationale. Si ce projet s’accompagne d’une véritable union des marchés internes, la monnaie unique pourrait redevenir une alternative crédible au dollar. C’était l’objectif affiché par Dominique Strauss-Kahn, alors directeur du FMI, avant qu’il ne soit brutalement écarté par un scandale aux relents de manipulation.
Paradoxalement, le yuan pourrait lui aussi aspirer à ce statut, bien qu’il reste en retrait. Fait révélateur : le Centre d’études économiques de l’Université de Pékin (CCER) a exprimé son intérêt pour une dévaluation coordonnée du dollar, inspirée d’une proposition formulée sous Trump. Cette manœuvre aurait pour effet de revaloriser le yuan, stimulant à la fois la consommation intérieure chinoise et la réindustrialisation américaine. L’idée est clairement assumée dans les cercles économiques chinois.
Un nouveau Yalta ? C’est une hypothèse parmi d’autres. Les Chinois explorent, comme à leur habitude, plusieurs options en parallèle.
Derrière ce jeu triangulaire — entre États-Unis, Union européenne et Chine — certains avancent, d’autres reculent
La Turquie a nettement renforcé sa position dans la région qu’elle ambitionne de dominer. Israël aussi. L’Inde progresse, mais de manière instable. La Russie, quant à elle, a perdu du terrain sur presque tous les fronts : en Eurasie, dans le Caucase, en Méditerranée. Elle est désormais dépendante, tant sur le plan économique que stratégique, de Washington et de Pékin. Elle ne conserve une marge de manœuvre que là où elle sert des objectifs anti-européens : Donbass, Sahel, Cyrénaïque. Ce qui montre qu’elle n’agit plus qu’avec l’aval implicite des États-Unis.
L’Iran, pour sa part, paie aujourd’hui le prix d’une stratégie anti-arabe et antinationaliste maladroite. Une stratégie autrefois financée et encouragée par Israël, qui, après en avoir tiré profit, ne la soutient plus.
Le Royaume-Uni, enfin, oscille entre déconfiture et tentatives de repositionnement
Avec le Brexit, il s’est infligé une double blessure, politique et économique.
Londres a perdu son rôle de relais stratégique des États-Unis en Europe, échoué dans sa relance du Commonwealth, et s’est privée de main-d’œuvre qualifiée et d’immigration européenne — aujourd’hui partiellement remplacée par une immigration pakistanaise —, tout en renonçant aux avantages de son statut privilégié dans l’Union.
Même sur le plan de la défense, le Royaume-Uni est en difficulté, davantage que les Européens continentaux — en particulier l’Allemagne, qui prévoit d’investir 1 000 milliards d’euros sur dix ans. Privée du soutien de la BCE, la dette britannique affiche des taux d’intérêt deux fois supérieurs à ceux de la zone euro. Il est essentiel de garder à l’esprit que Londres bénéficie de la livre sterling, une monnaie de référence à l’échelle mondiale, ainsi que de la City, l’un des principaux centres financiers internationaux. Si le Royaume-Uni paie un prix aussi élevé pour s’être affranchi de la tutelle de la BCE, on peut aisément mesurer à quel point les conséquences seraient dramatiques pour tout pays européen dépourvu de tels atouts — en particulier s’il venait à quitter la zone euro, comme le prônent encore certains opportunistes politiques.
Un bel exploit de la part des « économistes de l’exit », qui continuent de nous expliquer qu’on aurait tout à gagner à imprimer des billets de Monopoly…
Londres cherche désormais à revenir dans le jeu par la voie de coalitions ad hoc entre « volontaires », espérant ainsi retrouver un rôle sans perdre la face.
Car le prochain tournant, celui qui fera véritablement l’Europe — ou l’asservira définitivement aux intérêts américains et chinois — devra nécessairement dépasser les traités actuels et les institutions en place. Dans ce cadre, un retour du Royaume-Uni sans confession publique pourrait s’envisager.
La capitulation de von der Leyen : lecture d’un malentendu stratégique
Il n’y a jamais eu de réelle négociation : Trump était pressé, agissait par la force et disposait des arguments dissuasifs nécessaires. Les Européens, eux, comptent sur les effets progressifs d’un investissement commun et sur un désengagement partiel des États-Unis. Cette posture, par nature, les pousse à attendre.
Ursula von der Leyen semble sans doute mal préparée au rôle qu’elle est censée incarner. Il faut toutefois garder à l’esprit que l’ensemble du cadre européen reste encore très fragile — en particulier face à une superpuissance.
L’accord avec Washington prévoit des droits de douane américains, relativement modérés, sauf — et ce n’est pas un hasard — sur l’acier et l’aluminium, avec des hausses pouvant atteindre 50 %. Les engagements relatifs aux achats d’armement et d’énergie aux États-Unis ont, quant à eux, donné lieu à une mise en avant probablement exagérée.
Produire des armements plutôt que de les acheter constitue une différence essentielle, tant en matière d’indépendance stratégique que de souveraineté industrielle. Le secteur européen s’est déjà activement développé, avec sept programmes de défense lancés et quatre outils de financement et de coopération mis en place. Douze industries militaires de haut niveau sont engagées dans des projets majeurs, parmi lesquelles Leonardo — fleuron italien — joue un rôle de premier plan.
Acheter, en partie, des armements américains constitue une condition nécessaire à l’amorce d’un processus d’autonomisation progressive. Cela engendre aussi, inévitablement, une forme de dépendance : il serait impensable d’utiliser ces armes contre les États-Unis ou à l’encontre de leurs intérêts. Mais cette évidence n’en est plus une : personne n’envisage une guerre contre Washington. Même ceux qui revendiquent une autonomie stratégique — comme la Russie néo-impérialiste — possèdent du matériel militaire comportant des composants américains, voire des puces électroniques de fabrication californienne. La quasi-totalité des avions de chasse russes Su-35, par exemple, intègrent des éléments issus d’une chaîne de valeur triangulaire reliant la Chine à des sociétés comme Texas Instruments et Intel.
Et ce n’est pas tout. Malgré l’opacité des chiffres, la Chine reste aujourd’hui massivement dépendante de la propriété intellectuelle et des logiciels américains.
Une politique européenne d’indépendance doit viser à inverser cette dépendance et à renforcer l’industrie militaire continentale face à son homologue américaine. Prétendre que le réarmement européen serait un acte de soumission relève de l’ignorance, de la paresse intellectuelle ou de la démagogie.
Ce réarmement ne vise d’ailleurs pas à faire la guerre à la Russie. Le jour où Moscou sortira du bourbier qu’elle a elle-même creusé, elle aura d’autres priorités que de provoquer l’élargissement de l’OTAN à ses dépens.
Dans un système international en pleine reconfiguration, chaque acteur ne pourra jouer un rôle qu’à trois conditions : disposer d’un marché de capitaux profond, d’une centralisation politique effective et d’une crédibilité militaire avérée
Ce sont précisément ces leviers que les États-Unis s’efforcent souvent de freiner. Ainsi, anciens membres du Gladio, ex-généraux de l’OTAN, populistes souverainistes et partisans de la ligne MAGA sabotent les projets de défense européenne commune — et, hasard ou non, favorisent objectivement les intérêts russes, pays par pays. Ils sont tous impressionnés par des figures comme Poutine et Netanyahou, probablement parce qu’ils sont en quête constante d’un homme fort, ce qui ne correspond pourtant pas à ces derniers, car l’abus de pouvoir envers les plus faibles n’est rien d’autre que de l’impunité pure et simple.
L’Europe reste une puissance discrète, peu visible sur la scène politique mondiale, bien qu’elle ait su développer un potentiel remarquable malgré les nombreux obstacles — notamment ceux hérités de l’ordre de Yalta. Peu d’observateurs saisissent la profondeur réelle de ses dynamiques, de ses relations et de ses intérêts. Pourtant, les chancelleries du monde entier la considèrent déjà comme un acteur de premier rang.
Son potentiel repose notamment sur son capital humain, son expertise technologique, et sa capacité d’innovation
Le projet de “super-réseau” électrique européen, fondé sur la technologie UHVDC, pourrait acheminer en temps réel l’énergie solaire du bassin méditerranéen jusqu’en Scandinavie — une avance certaine sur les États-Unis. L’Europe pourrait même devenir une puissance énergétique majeure grâce à la technologie des supraconducteurs, déjà en développement en Allemagne.
Un fait pourtant majeur est passé presque inaperçu : en juin dernier, l’Union européenne a franchi un tournant historique sur la voie de la transition énergétique. Pour la première fois, l’énergie solaire a dépassé le gaz et le charbon dans la production d’électricité au sein de l’Union. Le photovoltaïque s’est ainsi imposé comme la première source d’électricité dans les 27 États membres, représentant 22,1 % de la production totale.
Combiné à un réarmement structuré et à une union des marchés intérieurs, ce socle permettrait à l’Europe de s’imposer définitivement comme un acteur géopolitique incontournable. Elle pourrait ainsi favoriser l’émergence d’un monde multipolaire — voire une forme de “triangulation mondiale” — capable d’offrir une alternative à l’unipolarité.
Sur cette question, la Chine elle-même est divisée : hésite-t-elle à encourager ou freiner ce processus ? Indirectement, elle en crée pourtant les conditions. Lors de la “guerre des cent heures”, le Pakistan a surpassé l’Inde grâce à ses missiles PL-15. New Delhi s’est retrouvée isolée face à un allié de Pékin soutenu par Washington, sans même bénéficier de la médiation traditionnelle de Moscou. Il en a résulté non seulement un envoi de munitions à l’Ukraine, via une triangulation avec l’Allemagne, mais aussi un rapprochement stratégique entre l’Inde, l’Europe et le Japon dans le but de mieux peser dans la région indo-pacifique.
En définitive, ce que la propagande russe attribue aux BRICS ou au soi-disant “Sud global” — la fin de l’hégémonie monétaire et l’émergence du multipolarisme —, seule l’Europe est aujourd’hui en mesure de le réaliser. À condition, bien entendu, de se doter d’élites compétentes.
Oui, le modèle européen devra évoluer
Oui, les nœuds démographiques et sociétaux devront être résolus.
Oui, l’Europe est encore prisonnière d’un capitalisme qu’elle partage avec les autres — mais elle conserve une sensibilité sociale que d’autres peinent à maintenir.
Oui, elle souffre encore des dérives intellectuelles et culturelles héritées de l’après-guerre et des excès de la pensée critique.
Mais tout cela ne saurait justifier un renoncement. Refuser de soutenir, avec lucidité et ambition, le rôle géopolitique de l’Europe reviendrait à condamner nos peuples et nos descendants à l’insignifiance.
Une Europe armée, réconciliée avec la notion de guerre — éternelle, naturelle —, que nous avons évacuée par une hypocrisie paresseuse, pourrait enterrer à la fois les illusions woke et les pacifismes inhibiteurs. Elle retrouverait alors le bon sens, la vitalité et une voie vers l’avenir.