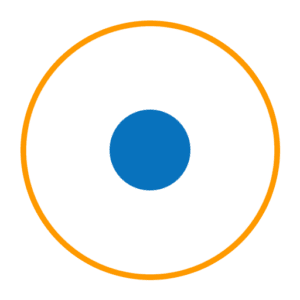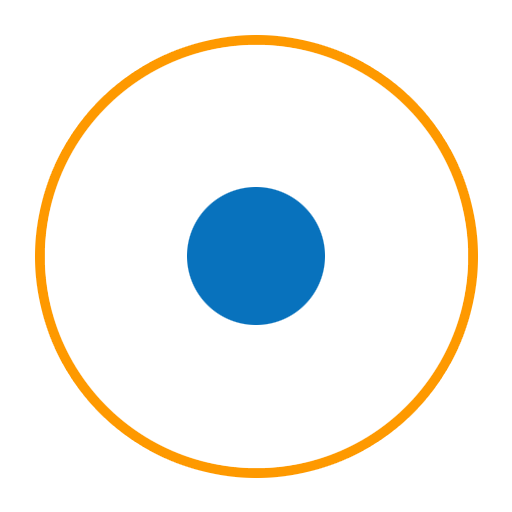Le siècle américain évoqué par l’économiste et essayiste italien Geminello Alvi touche-t-il à sa fin ?
Quel que soit le domaine que l’on considère, les États-Unis restent l’acteur hégémonique par excellence. Ils sont même la seule grande puissance dont la population continue de croître — à l’exception de l’Inde, qui demeure une puissance en devenir.
Cependant, ils peinent à gérer un système mondial toujours plus vaste, complexe et interconnecté.
Ils doivent faire face à la montée en puissance de la Chine et, plus largement, de toute l’Asie, comme ils l’ont fait autrefois avec l’Europe.
Ils doivent désormais composer avec des dynamiques nouvelles : l’impossibilité de gouverner un monde multi-aligné avec les seules lois du divide et impera, l’endettement excessif nécessaire au soutien de leur appareil militaire, ainsi qu’une série de problèmes internes de grande envergure.
Quant au dollar, fantasmes mis à part, il n’est actuellement menacé par personne.
L’euro, qui semblait un temps pouvoir lui faire concurrence, a été freiné.
La seule alternative réelle à la finance traditionnelle est aujourd’hui endogène : elle prend la forme du dollar numérique et d’une privatisation extrême du système, portée par la ligne Trump.
Mais sur ce front, comme sur ceux de l’intelligence artificielle ou de l’économie des ressources différenciées, les États-Unis doivent faire face à un talon d’Achille majeur : un réseau électrique obsolète et fragile, qui nécessiterait des milliers de milliards d’investissements pour être modernisé.
Voilà pour les États-Unis.
Quant aux alternatives agitées à grands cris, elles sont largement illusoires.
Il ne s’agit pas de modèles concurrents, mais simplement de variantes.
Peut-être seul le modèle chinois constitue-t-il une véritable alternative partielle : un hybride entre capitalisme de type américain et contrôle total de l’individu, jusqu’à sa dissolution.
Les autres ? De pâles copies de l’américanisme.
En Inde, on a Bollywood ; en Russie, le fast-food et le mode de vie américain en alphabet cyrillique.
L’Europe, quant à elle, a absorbé les « valeurs » américaines, en les reformulant à travers un humanisme certes louable, mais devenu aujourd’hui synonyme de pensée molle et de vie atone.
Les seuls pays qui ne suivent pas ce modèle sont ceux qui, objectivement, restent en retard — mais dont les peuples, paradoxalement, rêvent de l’Amérique et de l’Occident, et souhaitent massivement s’y établir.
Ceux qui ne perçoivent pas que les États-Unis dominent non par la contrainte, mais par un soft power redoutablement efficace, se bercent d’illusions à propos d’un prétendu front mondial de libération.
Ils tirent à blanc.
Il ne s’agit pas de blocs, mais de civilisations.
Ceux qui, depuis longtemps, dénoncent la toxicité du way of life américain se sont presque toujours cantonnés au registre intellectuel ou idéologique. Ils ont fini par présumer un antiaméricanisme diffus qui, dans les faits, n’existe pas — et ont ainsi manqué leur cible.
Des millions ont fui les régimes communistes, le Venezuela ou l’Iran.
Rien de tel n’est jamais arrivé dans les zones sous contrôle direct des États-Unis.
Cela ne valide pas la supériorité du modèle américain, mais démontre qu’il n’existe pas, pour l’heure, d’alternative perçue comme meilleure.
Les peuples qui ont combattu les Américains l’ont fait parce qu’ils furent agressés militairement (comme les Vietnamiens ou les Afghans), ou bien parce qu’ils vivaient sous des régimes ayant besoin d’un Ennemi pour légitimer leur pouvoir — comme l’Occident le fit avec l’URSS.
Même au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord, les pays les plus alignés sur les États-Unis (Maroc, Jordanie) sont aussi les plus stables.
Seule exception : l’Iran lors de la chute du Shah — mais il s’agissait alors d’une révolte islamique contre la modernisation et les campagnes de vaccination.
L’Amérique latine constitue le seul véritable bastion d’antiaméricanisme enraciné, car c’est là que les États-Unis sont intervenus avant d’avoir perfectionné leur soft power.
Ajoutons à cela le ressentiment discret mais réel du Japon post-Hiroshima et Nagasaki, savamment contenu dans des formes diplomatiques.
Pour le reste, l’antiaméricanisme n’est souvent qu’une antipathie instinctive envers la puissance, un rejet stérile qui finit presque toujours par se muer en soumission.
Ne pas en être conscient, c’est continuer à errer dans le brouillard.
L’Amérique souffre avant tout d’un trouble de l’âme et de la psychologie.
Son idéologie, née au XVIIe siècle, repose sur un mythe fondateur : le parricide.
Elle se construit autour de l’utopie de la Terre Promise, nourrie par le moralisme et la pulsion régénératrice de l’Ancien Testament, le tout formulé dans un matérialisme simpliste et brutal — mais terriblement efficace.
C’est le triomphe discret de la vulgarité.
Voilà le véritable ressort de la domination américaine, bien plus que l’impérialisme au sens strict.
Ignorer cela et s’exciter sur d’autres plans, c’est s’égarer dans des cris inutiles — hébergés sur des serveurs américains.
On ne combat pas un cancer par un autre cancer, encore moins s’il est aggravé par la lèpre. Et prétendre guérir le monde ainsi relève de la farce.
Penser que le bras de fer entre les États-Unis et leurs imitateurs ratés (des tyrannies dépourvues de soft power, comme la Russie, l’Iran ou le Venezuela) pourrait être décisif, c’est sombrer dans le pathétique.
Ces régimes sont trop dépendants de leurs propres maîtres pour constituer une alternative crédible.
L’illustration la plus flagrante de cette erreur réside dans l’interprétation contemporaine du rôle de l’OTAN.
Il ne s’agit pas seulement de rappeler que sa mission réelle n’a jamais été de menacer la Russie — à laquelle elle est en réalité utile — mais bien de neutraliser toute autonomie européenne.
Il s’agit surtout de réfuter cette idée absurde selon laquelle les Américains nous domineraient par la simple présence de leurs bases militaires.
Nous autres les italiens, nous avons signé un traité de dépendance : notre défense reste subordonnée aux décisions américaines. Les bases auraient été là de toute façon, OTAN ou pas.
Elles ne servent pas à mater des révoltes imaginaires, mais à projeter la puissance américaine vers la Méditerranée — voire à prévenir un retour de l’influence britannique.
Être antiaméricain tel qu’on l’entend aujourd’hui revient à jouer les antisémites de comédie.
Cela n’a aucun sens, et ne produit que des agités sans cap, qui hurlent à la lune sans jamais atteindre leur cible.
Dans leur caricature, ils rendent service — autant aux Américains qu’aux Israéliens —, selon qui se trouve dans leur viseur.
Et il n’est pas exclu que cette caricature ait été volontairement promue pour mieux neutraliser toute opposition sérieuse.
On peut dire que l’Amérique a su formaliser notre propre décadence, en érigeant l’Occident comme un lieu symbolique : celui « où meurt le soleil ».
Mais si elle a joué un rôle moteur dans notre chute, c’est bien notre propre déclin qui nous a précipités dans l’abîme.
Et ce n’est pas en désignant ceux qui nous ont aidés à tomber que l’on remontera la pente.
Se définir par l’opposition — être « anti » — est en soi un aveu de faiblesse.
Nous devrions incarner quelque chose d’authentique ; ce devrait être aux autres de se positionner comme « anti » par rapport à nous.
C’est ce que font les antifascistes.
Si nous exprimons une forme culturelle et politique cohérente, alors les Américains deviendront naturellement nos adversaires — parce que cela découle de la logique des choses.
Ce n’est pas en réhabilitant les goulags, les voileurs de femmes ou les bourreaux de manifestants que l’on devient un véritable opposant au modèle américain.
Ce n’est qu’en redevenant nous-mêmes — en redevenant l’Europe, en guérissant notre propre poison — que nous pourrons offrir une alternative réelle au grand gris qui nous engloutit, et dont l’Amérique est aujourd’hui la forme la plus accomplie.
Même disparus, les États-Unis pourraient encore survivre à travers ce modèle, revêtu d’un autre nom, durant des siècles.
Il ne peut y avoir de révolution véritable que si elle est centrée, créative, spirituelle, culturelle — et si elle propose une nouvelle mise en forme du monde. Seule la verticalité peut s’opposer à l’aplatissement.
Cesse une bonne fois pour toutes de chercher au loin le trésor enfoui dans ton propre jardin, aux racines mêmes de l’arbre de la vie.