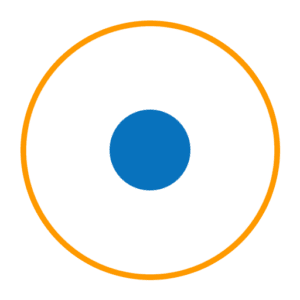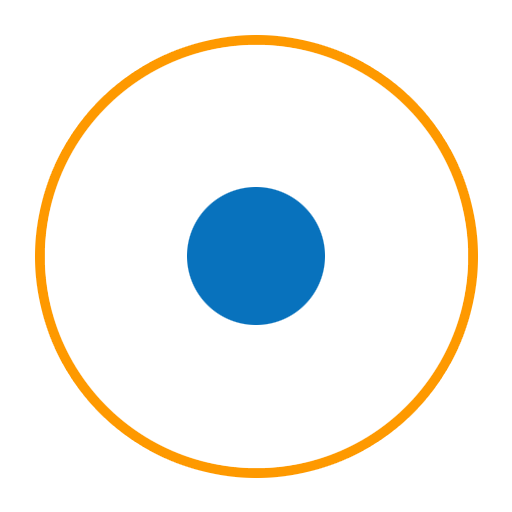Dans la nuit du 15 au 16 mars, à Paris, l’écrivain Pierre Drieu La Rochelle mit fin à ses jours.
Normand de pure souche, il consacra sa vie à la prise de conscience du déclin européen et au rêve viril de sa rédemption.
Avant son geste, il laissa près de lui un billet dans lequel il affirmait sa fidélité à l’idéal de la collaboration et reconnaissait la victoire de la résistance, déclarant qu’ayant perdu, il exigeait la mort.
Pour son œuvre de collaboration, plus littéraire qu’autre chose, et pour son retrait volontaire en 1943, il ne risquait sûrement ni la peine capitale ni une longue détention, mais il préféra agir comme un officier qui a perdu la guerre et veut conserver son honneur.
Au cours de sa vie, somme toute brève puisqu’il se donna la mort à 52 ans, il écrivit trente-cinq livres, dont plusieurs eurent un grand succès. L’un d’eux, Le Feu follet, fut adapté au cinéma après la Guerre par Louis Malle en 1963.
D’autres films s’inspirèrent ensuite de ses romans, notamment Une femme à sa fenêtre (1976) et La Voix (1992), tous deux réalisés par Pierre Granier-Deferre, ainsi que Oslo (2012), de Joachim Trier.
Le thème central de Drieu
qui est le fil rouge de Le Feu follet, fut toujours la mort. Il exprima constamment une pulsion suicidaire, mais un suicide cathartique, pour s’élever au-dessus des ruines, et non un suicide désespéré, car il était un homme de goût, de succès, et un séducteur raffiné de nombreuses femmes sublimes qui l’adorèrent toujours.
Son obsession ne concernait pas seulement sa propre mort, mais aussi celle de la civilisation. Avec elle, la force de l’homme pour l’accepter, mais aussi la nécessité de la régénération. C’est pourquoi il se rangea toujours du côté des forces vitales capables d’insuffler un élan viril à la société.
Déjà pendant la Grande Guerre, il fut frappé par l’incompétence des commandants et par la grandeur de l’initiative des courageux qui prenaient leur place. Il en témoigne dans ses mémoires, La Comédie de Charleroi.
De retour de cette expérience, dans l’espoir d’ébranler une société décadente, il fréquenta les milieux rebelles : surréalistes, communistes et monarchistes de l’Action Française.
Le 6 février 1934
les droites nationales protestèrent à Paris contre les scandales de corruption parlementaire. Depuis l’Assemblée Nationale, on tira sur les manifestants, y compris à la mitrailleuse. Il y eut 18 morts et des milliers de blessés.
Exactement onze ans plus tard, l’écrivain Robert Brasillach, accusé d’avoir collaboré avec les Allemands, fut fusillé près de Paris.
« Je pense à vous, morts du 6 février, et je serai parmi vous avec onze ans de retard », écrivit-il peu avant l’aube de son exécution. Ce texte figure dans le recueil La Mort en face, où il écrit également :
« On dit que le soleil et la mort ne peuvent être regardés en face. Pourtant, j’ai essayé. Je n’ai rien d’un stoïcien et il est douloureux d’être arraché à ce que l’on aime, mais j’ai essayé, pour ne laisser à ceux qui me verraient ou penseraient à moi qu’une image digne. »
Après ce bain de sang devant le Parlement, une autre manifestation eut lieu le 11 février, cette fois communiste. Il n’y eut aucun mort. Mais Drieu La Rochelle en tira la conviction que les partis servaient à diviser le peuple et que, uni, celui-ci aurait pu changer les choses.
Il s’engagea alors pour une ère nouvelle, fondée sur la force du peuple uni et le rêve de grandeur.
Il alla jusqu’à proposer la destruction de toutes les ruines antiques afin de ne plus s’endormir sur les lauriers du passé. Il comprit aussi que la France elle-même était dépassée, une idée qu’il avait déjà développée dans L’Europe contre les patries (1931).
En 1939, il se déclara ouvertement fasciste
dans son roman Gilles et s’engagea auprès du Parti Populaire Français de Jacques Doriot, ancien dirigeant communiste passé au national-socialisme.
Il écrivit pour la presse soutenant le gouvernement de Vichy, notamment Je suis partout et La Nouvelle Revue Française, dont il était le directeur.
Il commença alors à penser que non seulement les partis divisaient le peuple, mais que les nationalismes, au lieu de s’unir en une seule Internationale, divisaient l’Europe et la rendaient faible.
En 1943, dans un roman se déroulant en Amérique du Sud, L’Homme à cheval, il raconta le destin grandiose d’un condottiere rêvant de fonder une patrie impériale et emporté par l’échec d’une ambition poétique et romantique.
L’année suivante, dans Les Chiens de paille, il fut probablement le premier à parler de l’avènement du mondialisme.
À l’été 1943, il suspendit toute collaboration politique, estimant que la véritable Europe n’était pas en train de se construire.
Il écrivit alors un poème qui, après-guerre, devint le manifeste européen du néofascisme
Nous sommes les hommes d’aujourd’hui.
Nous sommes seuls.
Nous n’avons plus de dieux.
Nous n’avons plus d’idées.
Nous ne croyons ni à Jésus-Christ ni à Karl Marx.
Nous sommes seuls.
Il faut qu’immédiatement,
Sur-le-champ,
Dans cette seconde même
Nous construisions la tour de notre désespoir et de notre orgueil.
Il faut que, dans la sueur et le sang de toutes les classes,
Nous construisions une patrie comme on n’en a jamais vu,
Si serrée, un bloc d’acier, un aimant.
Toute la limaille de l’Europe s’y agrégera de gré ou de force.
Et alors, devant ce bloc de notre Europe,
L’Asie, l’Amérique, l’Afrique tomberont en poussière.
Dans la nuit du 15 au 16 mars, il laissa ces mots : « Nous avons joué, j’ai perdu : je réclame la mort. »
Son adversaire Jean-Paul Sartre lui reconnut cette sincérité en déclarant : « Il était sincère, et il l’a prouvé ! »
Après-guerre, il devint une référence pour l’idée de la Nouvelle Europe au sein des mouvements nationalistes révolutionnaires européens
Parmi ces figures, on retrouve le Français Maurice Bardèche, ami et beau-frère de Robert Brasillach, l’Anglais Oswald Mosley, l’Italien Filippo Anfuso, suivi ensuite par Adriano Romualdi, et le Belge Jean Thiriart.
Toutes les formations universitaires de la droite radicale s’inspirèrent de son œuvre.
Le premier livre d’un autre Normand illustre Jean Mabire (né de toute manière à Paris), lui fut d’ailleurs consacré : Drieu parmi nous, sans doute la plus belle œuvre jamais écrite sur lui, parue en 1963, l’année où Louis Malle portait à l’écran son roman existentialiste avant la lettre.
Jean Mabire incarna, tout au long de l’après-guerre, l’esprit européen et normand comme nul autre, écrivant plus d’une centaine d’ouvrages, entre romans et essais historiques, et formant au moins deux générations de jeunes militants.
Quatre-vingts ans plus tard
le souvenir de Drieu La Rochelle s’est quelque peu estompé. Un peu parce qu’aucun vitalisme ni aucun mythe n’anime les forces politiques actuelles, et un peu parce que, s’étant donné la mort, il n’a pas été tué par l’ennemi, ce qui empêche d’exercer, en le commémorant, cette subtile et inconsciente victimisation si présente dans les hommages.
Car on oublie toujours que : « Les héros ne doivent pas être pleurés, ils doivent être imités ! »