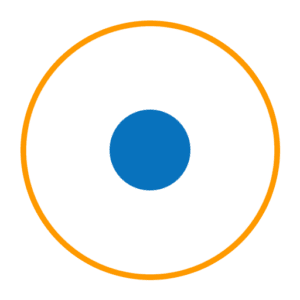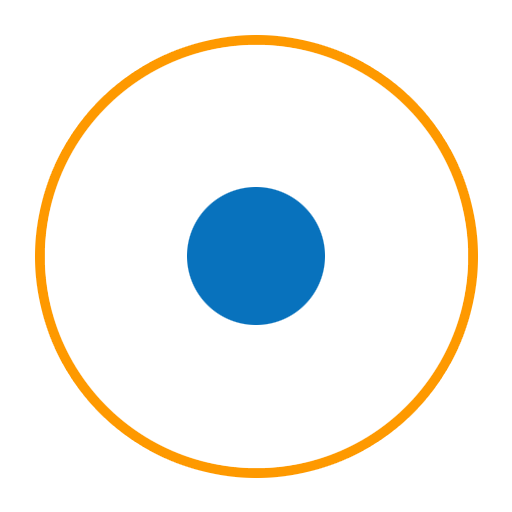Il est très probable qu’il s’agisse d’un piège destiné à pousser Zelensky et les Européens à rejeter les soi-disant “propositions de paix”. Les États-Unis pourraient ainsi s’aligner publiquement sur la Russie et fracturer l’Europe de l’intérieur : tel est le véritable objectif commun de Moscou et de Washington.
Jusqu’à présent, tout s’est déroulé comme prévu, selon un scénario annoncé de longue date
Rappelons les faits. Le 24 février 2022, la Russie envahit l’Ukraine, ignorant toutes les ouvertures européennes. Elle justifia l’attaque par des prétextes fragiles : l’existence supposée de laboratoires biologiques à sa frontière, une adhésion imminente de l’Ukraine à l’OTAN (qui n’était pas à l’ordre du jour) ou encore la défense des populations du Donbass. Moscou évoqua 14 000 victimes, alors que plus de 6 000 étaient des loyalistes, et qu’au cours des deux années précédentes on n’en comptait que soixante-dix-sept, dans un contexte de désescalade.
Dès décembre 2021, des rapports indiens, chinois et italiens de renseignement annonçaient une invasion, préparée en accord entre Poutine et Biden.
Cela peut sembler incroyable, mais pas autant que ça: en juillet 2021, l’Union européenne et Kiev avaient signé un accord donnant à l’Europe l’accès aux minerais rares du Donbass en échange de la pacification de la région. Quelques semaines auparavant, Poutine et Biden s’étaient rencontrés à huis clos. Aussitôt après l’accord, Moscou lança ses préparatifs de guerre.
Pendant ce temps, la Russie s’en prenait déjà aux intérêts européens au Sahel (depuis 2020) et en Cyrénaïque (depuis 2015). Elle restait un allié utile : elle n’avait, ni n’a par la suite, jamais cessé d’utiliser des armes comportant des composants américains, des programmes de lancement de missiles conçus en Californie et des avions de fabrication américaine. Encore aujourd’hui, Moscou fournit 12 % de l’uranium employé par l’arsenal nucléaire des États-Unis.
La Russie pensait conquérir l’Ukraine en un éclair
Elle marcha sur Kiev, allant jusqu’à parachuter des soldats en uniforme de parade.
Biden proposa d’évacuer Zelensky — un coup d’État prorusse à Kiev était peut-être prévu du début — mais celui-ci refusa. Grâce aux Javelins britanniques, les Ukrainiens remportèrent la bataille de Kiev et mirent en déroute la “deuxième armée du monde”. La Russie se concentra alors sur le Donbass : après une avancée initiale spectaculaire, elle fut repoussée à plusieurs reprises, subissant une défaite stratégique décisive dans la bataille pour ouvrir la route vers Odessa avant de réplier.
Les Ukrainiens lancèrent ensuite une vaste contre-offensive
Mais Washington se vanta d’avoir coupé le soutien satellitaire et d’avoir transmis à la Russie les informations nécessaires pour éviter la défaite.
En pratique, les États-Unis se rangèrent aux côtés de Moscou.
Une fois le risque d’effondrement russe écarté, Washington imposa de nouvelles restrictions : interdiction d’utiliser les missiles longue portée et limitations sévères pour ceux de moyenne portée. L’Ukraine dut alors miser sur la production massive de drones bon marché.
Il était clair pour tous — sauf pour les distraits — que Washington ne voulait pas que Kiev gagne la guerre. Et cela sous l’administration Biden, non Trump.
Ce n’est que durant la transition présidentielle américaine, grâce surtout à la position allemande, que l’administration sortante autorisa enfin Kiev à frapper en territoire russe.
En 2025
Trump commença par humilier publiquement Zelensky, puis par montrer son mépris pour l’Europe. Enfin, il accueillit Poutine comme un grand homme d’État, se comportant presque en serviteur. Ce dernier geste maladroit releve à la fois d’un excès théâtral et des premiers signes d’un déclin sénile.
Aujourd’hui vient le quatrième acte : tenter de partager l’Ukraine et d’ériger un nouveau Rideau de fer en Europe.
Autrement dit, une “Yalta 2.0” à l’échelle régionale plutôt que mondiale, hypothèse jugée absurde par les moins avertis lorsque je l’évoquais il y a trois ans et demi, mais désormais affichée par Russes, Américains et leurs relais.
Je l’ai toujours affirmé : chaque fois que la Russie échoue sur le terrain, les Américains interviennent pour lui offrir une issue.
Chaque fois qu’elle vacille, ce sont eux qui la sauvent.
Or aujourd’hui, la Russie vacille réellement
Il parait que non seulement parce que la propagande la dit victorieuse — des deux côtés, on entretient ce récit — mais la réalité est claire : si elle ne perce pas dans le Donbass (ou si ce territoire ne lui est pas concédé) d’ici la fin de l’automne, elle risque une capitulation pure et simple.
Les avancées russes sont presque toutes de la propagande
En un an, Moscou a progressé de 20 kilomètres de profondeur à peine, au prix de pertes colossales, et a reperdu presque toutes les localités conquises, présentées chaque fois comme “stratégiques” mais jamais tenues plus de deux jours. Ce ne sont pas des thèses avverses : les images satellites, accessibles à tous, le confirment.
Chassée de Tartous au point de dépendre d’Al Jolani, incapable de naviguer en Mer Noire sans se faire couler ses navires, Moscou a également perdu le Caucase il y a 10 jours après un accord turco-américain. Dans l’espace eurasiatique voisin, Chine, États-Unis et Europe se partagent désormais l’influence. La Russie dépend entièrement de Pékin, qui achète ses ressources à vil prix. Vladivostok est déjà de facto chinois. Sans capitaux chinois et occidentaux, elle est condamnée à ne plus inverser l’économie de guerre.
Même si on lui offrait le Donbass — qu’elle n’a pas réussi à conquérir en onze ans — Moscou a déjà perdu la guerre dans les faits. Sa seule victoire est celle de l’illusion.
Allons-nous vraiment lui offrir cette victoire artificielle : un Rideau de fer conçu à Washington ?
Après une résistance de façade et quelques artifices diplomatiques, c’est sans doute ce qui se dessine.
Mais le sort du Donbass dépendra de la décision américaine, non de la Russie, dont l’incompétence est telle qu’elle pourrait échouer même en étant favorisée.
Oui, il est possible que nous lui offrions ce trophée, mais rien n’est écrit. Car si la Russie domine la propagande et si l’Europe semble absente, en réalité l’Europe agit : réformes des traités, recherche quantique, production d’armements, accords multilatéraux avec l’Asie et l’Afrique, développement de l’IA, avancées vers l’intégration.
La véritable question est de savoir si les Européens accepteront la capitulation imposée par Washington — abandonner un peuple encore debout en échange d’une armée européenne pour une nouvelle guerre froide — ou s’ils choisiront d’assumer dès maintenant un défi avant tout moral : refuser d’imposer la reddition à ceux qui ne sont pas vaincus.
Nous verrons.
Ce qui compte, comme je l’ai répété dès le premier jour
c’est que, même si l’Ukraine paie le prix le plus fort, l’objectif n’a jamais été elle. La cible réelle — quelles que soient les sympathies ou les antipathies — a toujours été l’Europe, que les États-Unis cherchent à contenir en s’appuyant sur leurs éternels relais : les Russes.
On les dépeint comme puissants, mais ils sont en réalité considérablement affaiblis.
Il reste à voir quelles pressions Trump utilisera pour nous forcer à suivre sa ligne. Car, sénile ou non, il doit tenir compte d’une évidence : la réindustrialisation américaine dépend largement de l’Europe.
Ce film connaîtra-t-il une fin prévisible ?
Nous le saurons bientôt.
Jusqu’ici, le scénario a été respecté à la lettre.
Le seul acteur véritablement mauvais reste la Russie — mais elle excelle à se mettre en scène et à vendre du vent.