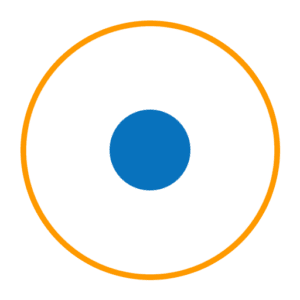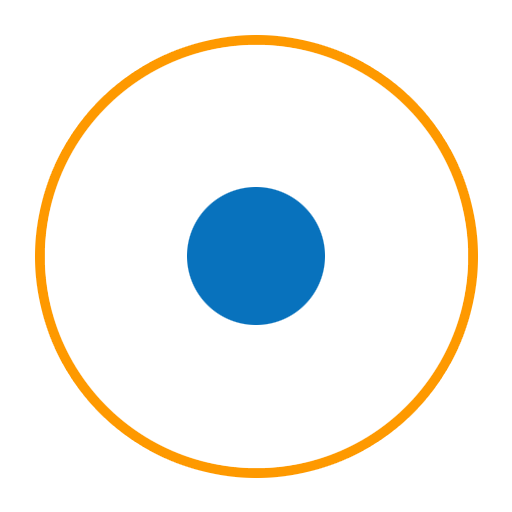Je reprends ici le débat que j’ai ouvert sur l’État profond afin d’apporter de nouvelles précisions. Ceux qui n’ont pas lu ma réflexion préalable gagneraient à la consulter : https://noreporter.org/lobsession-de-letat-profond/
sans cela, les développements qui suivent risquent d’être moins clairs.
J’affirme qu’aucune transformation n’est possible sans entrer sur le terrain, et ce terrain n’est autre que celui de l’État profond, avec lequel il faut nécessairement composer.
Mais que faut-il entendre par là ?
Il ne s’agit ni d’« entrisme », ni de la prétention de s’emparer des lobbies existants. Il s’agit, au contraire, de créer de nouveaux foyers de pouvoir et de dialoguer avec la société. La rhétorique populiste, en réduisant l’État profond à une entité artificielle ou illégitime, en nie la véritable nature : celle du tissu souterrain qui, depuis toujours, structure chaque société et chaque État. Il ne se confond qu’en partie avec les institutions, car il est—par essence et par nécessité—largement indépendant du verdict des urnes.
Cet « État profond » comprend
loges, lobbies, fonctionnaires, associations, militaires, policiers, journalistes, magistrats, enseignants, ONG, paroisses, et bien d’autres encore.
Si l’on admet que cette galaxie constitue le véritable pouvoir—plus stable et moins fragile que celui des institutions parlementaires ou gouvernementales—on comprend qu’elle rassemble des entités extrêmement diverses.
On ne peut pas réformer une loge ou un lobby en y adhérant.. Mais il est possible, avec patience, de transformer les rapports internes à des catégories ouvertes—fonctionnaires, enseignants, militaires, magistrats—et d’y constituer de véritables « lobbies populaires » au moins au niveau local, ou même de créer des ONG alternatives.
La crainte que les oligarchies dominantes, unies par une logique subversive, fassent bloc de manière compacte, n’est fondée qu’en partie. Elle l’est parce que—sur ce point le populisme a raison—la classe dirigeante traverse une crise profonde. Mais cela ne signifie nullement que le système de pouvoir s’effondre. Celui-ci évolue, tandis que l’élite progressiste n’arrive plus à en contrôler ni le processus ni le récit. Elle se condamne elle-même en s’accrochant à des idéologies utopiques, pacifistes, fragiles et « woke ».
Je ne suis certes pas marxiste
mais certaines intuitions de cette tradition demeurent valables. Parmi elles, l’idée que l’idéologie dominante reflète les intérêts de la classe dirigeante. Mais encore faut-il que cette idéologie accompagne ses besoins matériels et les contraintes de l’époque. Or, dans un contexte où la guerre redevient une idée familière (et peu importe contre qui, l’essentiel étant la simple possibilité de la guerre), les idéologies affaiblies doivent être corrigées. La logique subversive qui a accompagné la mondialisation doit céder, au moins partiellement, la place à une logique constructive, différente par nature de celle encore dominante.
Il ne faut cependant pas nourrir d’illusions excessives : tout cela se déroule dans une période de forte dénatalité, principal problème de nos sociétés. Et l’existence de conditions favorables ne garantit rien sans l’action de forces capables d’en tirer parti.
C’est là que réside le véritable nœud
Jusqu’à présent, le populisme—de droite, de gauche et même du centre—a fondé toute sa stratégie sur l’idée que l’oligarchie allait s’effondrer, jusqu’à inventer le slogan absurde du « peuple contre les élites », comme si l’histoire n’avait pas toujours été le fruit des rivalités entre élites.
Il a parié sur la disparition impossible de l’État profond, misé sur la simple dénonciation et le vote de protestation, en négligeant les structures réelles du pouvoir.
Pour reprendre la formule du ministre socialiste craxien italien De Michelis, il s’est contenté de regarder ce qui est « sur la table », en ignorant ce qui se joue « sous la table ».
Or, les nécessités concrètes priment toujours sur les dogmes idéologiques. Lorsque les populistes ont gouverné des villes ou des régions (Ligue et Cinq Étoiles en Italie, Rassemblement National en France), ils ont dû se montrer bien plus pragmatiques que ne l’exigeait leur rhétorique, au point d’être accusés de trahison.
Le déficit est en amont
une logique binaire et antagoniste, fondée sur des dogmes, paralyse l’action. Même lorsqu’elle attire un certain consensus, elle ne débouche que sur des compromis fragiles, car sans principes fixes. Tout repose sur l’opposition pour l’opposition, et conduit à des compromis perdants.
Il a aussi manqué une véritable réflexion sur l’adversaire, systématiquement diabolisé ou ridiculisé.
On l’a vu dans le cas de la transition écologique, bien plus complexe qu’on ne l’imagine, et encore plus avec la question des vaccins. Personnellement, j’ai toujours douté de l’efficacité de l’ARN contre le COVID, mais le discours populiste dominant a sombré dans le complotisme, y voyant un instrument d’extermination, de stérilisation ou de contrôle—comme si nous ne vivions pas déjà dans une société de transparence permanente.
Pourtant, Israël, dont le système de santé est parmi les plus avancés, a vacciné massivement sa population ; les États-Unis viennent d’annoncer un vaccin universel contre le cancer basé sur l’ARN ; et la Russie l’a rendu obligatoire depuis peu.
Cela ne prouve pas que le choix fut juste, et je reste sceptique. Mais réduire les élites à des marionnettes de complots sataniques ou à des imbéciles ne permet ni de comprendre la réalité ni d’y intervenir autrement que par des réactions stériles.
Pour agir efficacement
il faut une vision du monde claire, solide, assumée avec conviction calme et déterminée, et la constitution d’une minorité active, organisée. Sans cela, il n’y a pas de véritable issue. Même l’union de toutes les dissidences ne suffirait pas, car elle saurait seulement où ne pas aller, sans jamais savoir où aller.
De plus, la certitude populiste d’être majoritaire relève du mirage : ses principales formations recueillent rarement plus d’un tiers des suffrages (moins d’un cinquième des électeurs inscrits). Quant à son autoproclamation comme représentant du peuple, elle est fallacieuse : sur presque toutes les grandes questions, la société est coupée en deux blocs équivalents, ce qui conduit à l’immobilisme.
Le passage de la protestation à l’action
exige une prise de conscience profonde, suivie d’une stratégie précise : agir à l’échelle locale, construire de nouveaux espaces de pouvoir, reconstruire le tissu social. Bref, reconstruire les fondations pour transformer l’édifice institutionnel jusqu’à son sommet.
Saisir cette nécessité, c’est dépasser la fausse dichotomie entre électoralisme et activisme extra-parlementaire. L’essentiel est d’articuler les multiples réalités qui composent la société et, donc, le pouvoir, en établissant une complémentarité entre elles.
Celui qui agit dans le réel peut choisir ou non d’investir l’institutionnel, selon sa vocation et son tempérament. Mais tant que ces actions ne sont pas stériles, elles tendent à s’équilibrer et à faire émerger de nouvelles minorités actives, que l’on espère adaptées aux défis à venir.
Ce chemin a déjà été esquissé, dans plusieurs pays et localités, mais de façon instinctive, par simple disposition. Tant qu’il ne deviendra pas stratégie, il ne saurait constituer une véritable alternative aux oligarchies subversives dominantes.