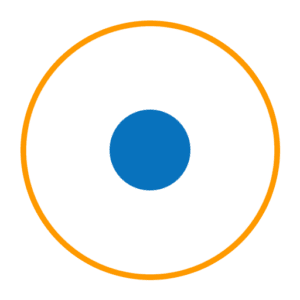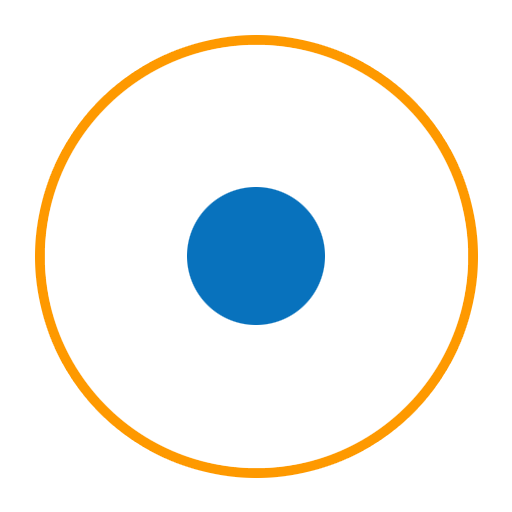Des modèles, des symboles et des références façonnent les actions dans la vie et l’histoire.
Riyad suit dans le sillage de Yalta
dans l’esprit d’un “Yalta 2.0” impliquant l’Europe, le Proche-Orient et une partie de l’Afrique.
Riyad suit la trace de Yalta, dans l’esprit d’un Yalta 2.0 qui implique l’Europe, le Proche-Orient et une partie de l’Afrique.
En réalité, plus que Yalta – où, en février 1945, furent scellés les destins des peuples soumis à l’internationale des criminels et des marchands – le sommet des bandits en Arabie Saoudite renvoie à Téhéran, où, fin novembre 1943, ces destins furent décidés.
Yalta reste néanmoins le symbole, le modèle
Désormais, on ne parle plus que de cela et, ironie involontaire, on l’exalte comme un élément stabilisateur.
« Super, nous serons de nouveau esclaves ! » s’exclame joyeusement un affranchi à qui la liberté a été retirée dans le film italien « Scipion, dit aussi l’Africain ».
En réalité, à Riyad, on a très peu parlé de l’Ukraine
mais beaucoup de l’exploitation des terres rares, du développement de pipelines et du partage du butin, avec un mépris complet pour tous les sujets de la planète.
Et il y a même – et ils ne sont pas rares – ceux qui se réjouissent parce que le vice-président américain Vance, qui n’a aucun pouvoir réel et qui est un personnage inquiétant (étant donné qu’il a même changé de confession religieuse alors qu’il était très jeune pour gravir les gradins de l’establishment), a humilié les Européens.
Imagineriez-vous un futur Chancelier allemand se félicitant parce qu’un représentant de la France aurait humilié les Allemands dans la Ruhr en 1923, simplement parce qu’ainsi c’était une gifle à Weimar ?
Weimar, précisément
semble être le modèle choisi par l’UE, avec des réunions sans conclusion et mille positions divergentes, comme par exemple à Paris lundi soir.
Weimar, où régnait la décadence, où les questions de genre et un mouvement pré-woke commençaient à émerger, et où l’on prétendait pouvoir redresser l’Allemagne uniquement par l’économie et la diplomatie.
Cette parenthèse allemande, fondée sur le processus économique unificateur rhénan du Zollverein et reprise dans la conception d’une Europe qui – hélas, hélas, hélas – ne s’est jamais vraiment unie et n’a jamais eu de pouvoir central, fut d’ailleurs moins désastreuse que ce que retient la mémoire historique.
Pendant la période de Weimar
il y eut de nombreuses pulsions et tendances, mais tous les opposants n’étaient pas anti-allemands, tout comme, aujourd’hui, ceux qui vocifèrent contre l’UE ne sont pas nécessairement anti-européens.
Il y avait ceux qui – comme le font aujourd’hui de nombreux exaltés du néant – se réjouissaient de chaque humiliation allemande car, qu’ils soient communistes ou de la droite monarchiste, ils espéraient être dominés par les Russes ou devenir les laquais de Londres.
Mais il y avait aussi ceux qui, opposés à la classe dirigeante de Weimar, voulaient une Allemagne unie, forte, engagée et n’étant soumise à aucune influence, ni interne ni externe.
Ce sont eux qui ont clos la parenthèse de Weimar
Ils aimaient leur propre peuple, leur propre terre; ils étaient animés par la dignité et ne se considéraient pas comme des citoyens du monde, au point de ne jamais exiger d’être aux ordres de quiconque – non de Staline ou de Chamberlain, ni même de Mussolini.
Aujourd’hui, en revanche, beaucoup ont une imagination globalisée et parlent de Trump, de Poutine, de Netanyahu, comme s’ils étaient ici et comme s’ils étaient compatibles avec notre histoire, avec notre génie du lieu, avec notre être.
Cependant, ces derniers avaient la foi, ils n’étaient pas éteints, ils n’étaient pas morts, et ils ne se moquaient pas de ceux qui, dans le désastre et la décadence la plus totale – comme en 1923 ou en 1929 – croyaient en l’Allemagne, sans prétendre qu’elle était morte à Verdun ou à Versailles.
Trouve la différence
et tu comprendras pourquoi nous sommes faibles, et tu sauras comment nous renaîtrons.
Avec toi ou sans toi !